Joachim Patinir, la Traversée du Styx : incarner la névrose phobique
- Fabrice LAUDRIN

- 26 févr. 2025
- 10 min de lecture
Patinir, J. (1520-1524). Paysage avec Charon traversant le Styx [Huile sur bois].
Musée du Prado, Madrid, Espagne.

À l’aube du XVIe siècle, Joachim Patinir, peintre flamand, invente un genre nouveau : le paysage devient le sujet central de la peinture, et non plus un simple décor destiné à mettre en scène des figures religieuses ou mythologiques.
Son travail s’inscrit dans un contexte où l’Europe, marquée par la Réforme et les bouleversements humanistes, cherche à repenser sa relation au divin et à la nature. L’homme n’est plus seulement un acteur du sacré, il est un être en suspens, en quête de sens, perdu dans l’immensité du monde.
Paysage avec Charon traversant le Styx (1520-1524) est l’une des œuvres les plus emblématiques de cette évolution.
Commandé par un mécène partagé entre l’orthodoxie chrétienne et les spéculations des penseurs antiques, Paysage avec Charon traversant le Styx n’est pas une simple transcription mythologique. Il est une mise en scène de l’indécision ultime, une méditation picturale sur l’instant suspendu où l’âme vacille, où l’avenir s’écrit sans qu’aucune main ne le dirige encore. La Renaissance flamande, réputée pour son attention méticuleuse aux détails et son attachement au réel, offre ici une vision plus trouble, plus métaphysique. La précision du trait ne sert plus seulement à décrire le monde, elle devient une manière d’épaissir le mystère.
Joachim Patinir ne peint pas un simple paysage, il construit un espace mental, une cartographie du destin, où la pensée chrétienne et l’héritage antique coexistent dans une tension insoluble. Ici, la nature n’est pas un décor, elle est une architecture symbolique, une topographie spirituelle où chaque élément porte le poids d’un choix.
Au centre, le Styx, cet entre-deux liquide qui n’a rien d’un simple fleuve. Il est un seuil, une fracture dans l’image, une ligne de partage qui ne promet ni un bord ni l’autre, mais qui impose un vertige. Charon, silhouette impassible, rame sans se soucier de l’angoisse de son passager. L’âme, elle, n’a pas encore franchi le point de non-retour. Ni son corps ni son regard ne disent quoi que ce soit de son destin. Elle ne choisit pas, elle attend. Patinir peint moins une traversée qu’un flottement, un temps suspendu où la décision n’appartient plus à celui qui l’a prise.
De part et d’autre du fleuve, deux visions du monde s’opposent avec une clarté brutale.
À gauche, le Paradis chrétien, baigné d’une lumière douce, peuplé d’anges, où la nature s’épanouit en une symphonie de verts clairs et de bleus tendres. Ici, la terre est hospitalière, le sentier s’élève dans une progression fluide, presque naturelle, vers une brèche lumineuse qui semble accueillir plutôt qu’imposer un jugement. L’œil y trouve un apaisement, une respiration. C’est un monde de continuité, un passage adouci, un au-delà qui s’offre sans menace.
À droite, l’Enfer tel qu’un esprit lettré du XVIe siècle pouvait l’imaginer, entre théologie et mythologie païenne. Loin d’être une simple inversion du Paradis, il est un territoire structuré, une forteresse du châtiment. Une tour domine le paysage, matérialisation des cercles infernaux qui s’emboîtent comme des rouages inéluctables. Cerbère, fidèle à son rôle, garde l’entrée, tandis que des âmes errantes longent la rive du Styx, figées dans une éternité sans direction. D’autres, plus résignées, semblent s’abandonner à la chaleur d’un brasier. Ici, tout est clôture, enfermement, inertie. L’Enfer n’est pas un lieu de supplice, il est une destination sans issue, une impasse que plus rien ne viendra perturber.
Et entre ces deux rivages, le Styx, cette eau incertaine, grise, trouble, qui ne dit rien de son cours. Est-il une route ? Un piège ? Un miroir qui absorbe toute perspective ? L’âme qui le traverse ne sait pas. Elle ne regarde ni le Paradis ni l’Enfer, elle fixe la surface liquide comme si l’essentiel était là, dans cette matière mouvante qui ne donne aucune réponse.
Les couleurs jouent ce même jeu d’opposition. Le Paradis se drape de verts lumineux, de bleus limpides, de blancs apaisants. L’Enfer s’enfonce dans des rouges agressifs, des noirs charbonnés, des bruns terreux qui alourdissent la matière. Et entre ces deux pôles, le Styx demeure une énigme, un gris-bleu froid, indéfini, un espace qui ne s’engage ni d’un côté ni de l’autre.
Ce tableau est plus qu’une image du passage de l’âme, il est une représentation de l’attente, du seuil qui ne se franchit pas, du vertige face à l’inconnu. Il incarne ce moment où l’homme du XVIe siècle, nourri de Bible et de philosophie antique, hésite entre deux visions du monde, entre deux manières de penser l’après.
Mais au fond, l’âme traverse-t-elle vraiment ? Rien n’est moins sûr. Tout indique que c’est le Nocher lui-même qui détient le pouvoir, que ce n’est pas l’âme qui choisit sa rive, mais Charon, ce passeur muet, cet "Outre-Soi" qui a déjà décidé pour elle. Et dans cette barque où elle ne contrôle rien, elle comprend peut-être que la traversée n’est pas un passage, mais une dépossession.
La névrose phobique est l’angoisse du seuil à l’état pur.
Là où l’obsessionnel tente de verrouiller tout passage par le contrôle, là où l’hystérique oscille sans jamais s’arrêter, le phobique, lui, bloque net. Ce n’est pas qu’il ne sait pas avancer, c’est que l’idée même d’un franchissement est perçue comme une menace insurmontable. La phobie ne se contente pas d’être une peur, elle est une organisation du monde autour d’un interdit, une cartographie mentale qui classe certaines zones comme impraticables.
Le sujet phobique évite. Il contourne, il met en place des stratégies de fuite ou d’évitement, il érige des béquilles symboliques – objets fétiches, rituels, pensées magiques – pour s’assurer que ce seuil-là ne sera jamais franchi. L’objet-phobique (araignée, ascenseur, espace vide ou trop plein) n’est jamais que la face visible de cette construction défensive. Ce qui fait réellement peur, ce n’est pas l’objet en soi, mais ce qu’il représente : une perte de contrôle, une traversée imposée, un basculement qui n’offre aucune garantie.
La psychanalyse du seuil ne traite pas la phobie comme un simple symptôme à désensibiliser. Elle ne cherche pas à forcer le passage. Elle interroge le seuil lui-même. Pourquoi cette ligne-là et pas une autre ? Pourquoi cette frontière psychique s’est-elle figée ? Que protège-t-elle ?
Et c’est précisément là que Paysage avec Charon traversant le Styx de Joachim Patinir devient une image parfaite de la structure phobique.
Le Styx ou l’impossible franchissement
Ce tableau est l’illustration d’un passage qui ne se fait pas. Tout y est organisé autour d’un entre-deux suspendu, d’un seuil qui s’impose comme une menace plus que comme une transition naturelle.
L’âme, sur la barque, est figée. Elle ne regarde pas où elle va, elle regarde ce qui la retient. Elle est en transit, mais ce transit n’a rien d’une progression. Il est un flottement anxieux, une attente crispée. Elle ne sait pas où elle sera déposée – mais est-elle seulement capable de s’imaginer quelque part ?
Car de chaque côté du Styx, tout est trop défini.
Le Paradis, à gauche, est un espace d’ouverture, de lumière, de continuité. Il est fluide, logique, il propose une issue qui n’exige pas de rupture. Mais pour le sujet phobique, cette clarté elle-même peut être terrifiante. Le passage vers un espace où tout est déjà écrit est une forme de dépossession. Si la route est tracée, alors le choix n’existe plus.
L’Enfer, à droite, est un monde de clôture. Un espace structuré, saturé de limites, dominé par la tour qui évoque une forteresse. Rien ne s’y échappe, rien ne s’y décide. C’est la réclusion absolue, la disparition du sujet sous un ordre imposé. Là encore, la perspective d’une arrivée est synonyme d’annulation : ce n’est pas une traversée, c’est une capture.
Et au centre, le Styx, gris, indéfini, une étendue d’eau sans promesse, l’incarnation parfaite de la phobie du passage. Ce n’est pas un simple fleuve, c’est un gouffre psychique, un espace où l’on ne peut pas se projeter. Il ne mène pas quelque part, il absorbe. Il est l’équivalent du moment de panique pure où le sujet phobique perd ses repères : un espace mental où plus rien n’est stable, ni le corps, ni l’identité, ni la pensée.
Le sujet phobique n’a pas peur de l’issue, il a peur du Styx lui-même. Ce fleuve est ce qui symbolise, dans son angoisse, l’impossibilité de contrôler un passage, l’incapacité à savoir ce qui va advenir. C’est pourquoi il évite. C’est pourquoi il contourne, s’invente des objets fétiches, des échappatoires : tout plutôt que de se retrouver au cœur de ce vide qui aspire toute certitude.
Charon, ou l’Autre qui décide à sa place
Mais il y a un autre élément fondamental dans la structure phobique : le Nocher.
Dans le tableau, ce n’est pas l’âme qui rame. Ce n’est pas elle qui choisit où elle va. Elle dépend de Charon, ce passeur impassible, cet "Outre-Soi" qui détient le véritable pouvoir. Le sujet phobique fonctionne exactement de la même manière : il délègue, il s’en remet à des figures extérieures pour organiser le monde à sa place.
L’obsessionnel verrouille, l’hystérique interpelle, le phobique attend qu’on le guide. Il ne traverse pas seul, il attend que l’Autre décide pour lui. Mais cette attente est elle-même insupportable, car elle confirme que le sujet ne contrôle rien. D’où l’évitement, d’où la mise en place de subterfuges pour ne jamais avoir à monter dans cette barque, pour ne jamais se retrouver dans un moment où l’Autre impose une traversée.
Dans Paysage avec Charon traversant le Styx, tout repose sur ce rapport de force implicite. L’âme ne maîtrise pas son déplacement. Elle est dans la barque, mais ce n’est pas elle qui la mène. C’est exactement ce que vit le sujet phobique dans un moment d’angoisse : il se sent transporté contre son gré, il perd toute maîtrise, il ne sait pas où il va.
Cette œuvre de Patinir nous livre ici une vérité brutale et incompressible : le seuil existe, qu’on le traverse ou non.
L’âme peut refuser de choisir, elle peut rester figée, elle peut détourner le regard. Mais la barque avance quand même. Ce n’est pas parce qu’on n’accepte pas un passage qu’il disparaît. Il est là, il opère, et l’attente ne fait que prolonger l’angoisse.
Bibliographie
Histoire de l’art et analyse du tableau
Baticle, J. (1992). Le Siècle de Titien: L’âge d’or de la peinture à Venise. Réunion des Musées Nationaux.
Bonnefoit, R. (2000). La Renaissance flamande: Entre réalisme et spiritualité. Hazan.
Dacos, N. (1995). Patinir et la première peinture de paysage en Occident. Gallimard.
Delieuvin, V. (2021). Figures de la Renaissance: Peinture et humanisme en Europe. Louvre Éditions.
Legrand, G. (2015). L’Invention du paysage: Histoire d’une idée entre art et nature. Éditions du Seuil.
Télot, J. (2017). Le Paradis et l’Enfer dans la peinture européenne. Flammarion.
Philosophie et psychanalyse appliquées à l’image du seuil et de l’angoisse phobique
Anzieu, D. (1985). Le Moi-peau. Dunod.
Bachelard, G. (1942). L’Air et les Songes: Essai sur l’imagination du mouvement. José Corti.
Bergson, H. (1896). Matière et mémoire. Presses Universitaires de France.
Camus, A. (1942). Le Mythe de Sisyphe. Gallimard.
Dufour, D.-R. (2003). L’Art de réduire les têtes: Sur la nouvelle servitude de l’homme libéré à l’ère du capitalisme total. Denoël.
Freud, S. (1920). Au-delà du principe de plaisir. Payot.
Lacan, J. (1973). Le Séminaire, Livre XI : Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. Seuil.
Maleval, J.-C. (2018). Les psychoses ordinaires et les phénomènes élémentaires. Presses Universitaires de Rennes.
Roudinesco, E. (1993). Histoire de la psychanalyse en France, 1885-1939. Fayard.
Weil, S. (1947). La Pesanteur et la Grâce. Plon.
Yalom, I. (1980). Thérapie existentielle et angoisse de la mort. Gallimard.
Approche psychanalytique du phobique et de la peur du passage
Chouvier, B. (2017). Le Sujet et ses fictions: Psychanalyse du roman familial. Dunod.
David, M. (2007). L’Angoisse et ses défenses: Une lecture psychanalytique des névroses et des phobies. Presses Universitaires de France.
Green, A. (1990). La Folie privée: Psychanalyse des cas limites. Gallimard.
Nasio, J.-D. (2010). L’Inconscient à l’œuvre. Payot.
Revault d’Allonnes, M. (2012). La Peur et l’humanité. Éditions du Seuil.
Tisseron, S. (2018). Les Bienfaits de l’angoisse: De la peur à la créativité. Albin Michel.
Notions de psychanalyse croisées
La névrose phobique
La phobie est une structure névrotique où l’angoisse se cristallise autour d’un objet ou d’une situation redoutée. Le sujet phobique met en place des stratégies d’évitement et des objets-talisman pour contourner l’angoisse liée au passage. Dans Paysage avec Charon traversant le Styx, l’âme dans la barque est figée, incapable de choisir son destin, incarnant parfaitement l’indécision phobique face à un seuil perçu comme menaçant.
Le Seuil
Concept central en psychanalyse du seuil, il désigne un espace de transition, un moment de bascule où l’identité et la perception de soi vacillent. Le Styx de Patinir représente ce seuil par excellence : un passage qui n’est ni un départ ni une arrivée, mais un état intermédiaire où le sujet se trouve suspendu.
L’angoisse
L’angoisse, chez Freud, est une réaction face à un danger perçu, qu’il soit interne (pulsionnel) ou externe (réel). Pour Lacan, elle est le seul affect qui ne trompe pas, car elle révèle une menace sur l’intégrité du sujet. Dans la névrose phobique, l’angoisse est projetée sur un objet extérieur (exemple : le Styx, dans le tableau), mais son origine est plus profonde : la peur du passage et de la transformation.
L’Objet phobique
Freud décrit l’objet phobique comme un substitut de l’angoisse primaire. Il permet de canaliser l’angoisse diffuse sur un point précis (une araignée, un lieu, une situation) pour mieux l’éviter. Ici, le Styx joue ce rôle : il condense toutes les angoisses du passage et devient l’objet redouté par excellence.
L’Autre comme garant du passage
Dans la structure phobique, le sujet délègue souvent la gestion du passage à un tiers, un guide ou un garant. Dans le tableau, Charon incarne cet Autre : c’est lui qui détient le pouvoir de traversée. Le sujet phobique, comme l’âme représentée, attend une décision extérieure, mais cette attente elle-même devient insupportable.
L’angoisse de la dépossession
L’une des terreurs fondamentales du phobique est la perte de contrôle. L’attente dans la barque représente ce moment où le sujet réalise qu’il n’a plus la main sur son propre devenir. L’angoisse ne naît pas seulement de la peur de l’Enfer ou du Paradis, mais de l’impossibilité de maîtriser ce qui va advenir.
Le fétiche et l’évitement
Freud et Lacan ont montré que le phobique met en place des fétiches et des objets de substitution pour éviter l’angoisse. Ici, l’âme pourrait s’accrocher à Charon comme à un garant, ou se focaliser sur la surface du Styx plutôt que d’affronter son issue finale. C’est un mécanisme classique de détournement de l’angoisse.
La temporalité suspendue
Le tableau capture un instant qui semble figé, caractéristique de la temporalité phobique. L’angoisse du seuil fige le sujet dans une attente perpétuelle, où le temps se dilate et où toute avancée est repoussée. Cette suspension est au cœur de la phobie : ne pas bouger pour ne pas risquer.
L’Autre comme menace et comme recours
L’Autre est à la fois celui qui rassure et celui qui impose le passage. Le phobique oscille entre ces deux positions : il cherche un garant, mais redoute d’être forcé. Charon, dans le tableau, symbolise cette ambivalence : il est le passeur, mais aussi celui qui prive l’âme de son autonomie.
Le déni du passage
Le dernier mécanisme phobique est le refus d’admettre que le passage est inévitable. L’âme pourrait se convaincre qu’elle peut rester indéfiniment sur l’eau, sans jamais être conduite à l’une des deux rives. Cette illusion est au cœur de la névrose phobique : croire que l’on peut éviter l’inévitable.



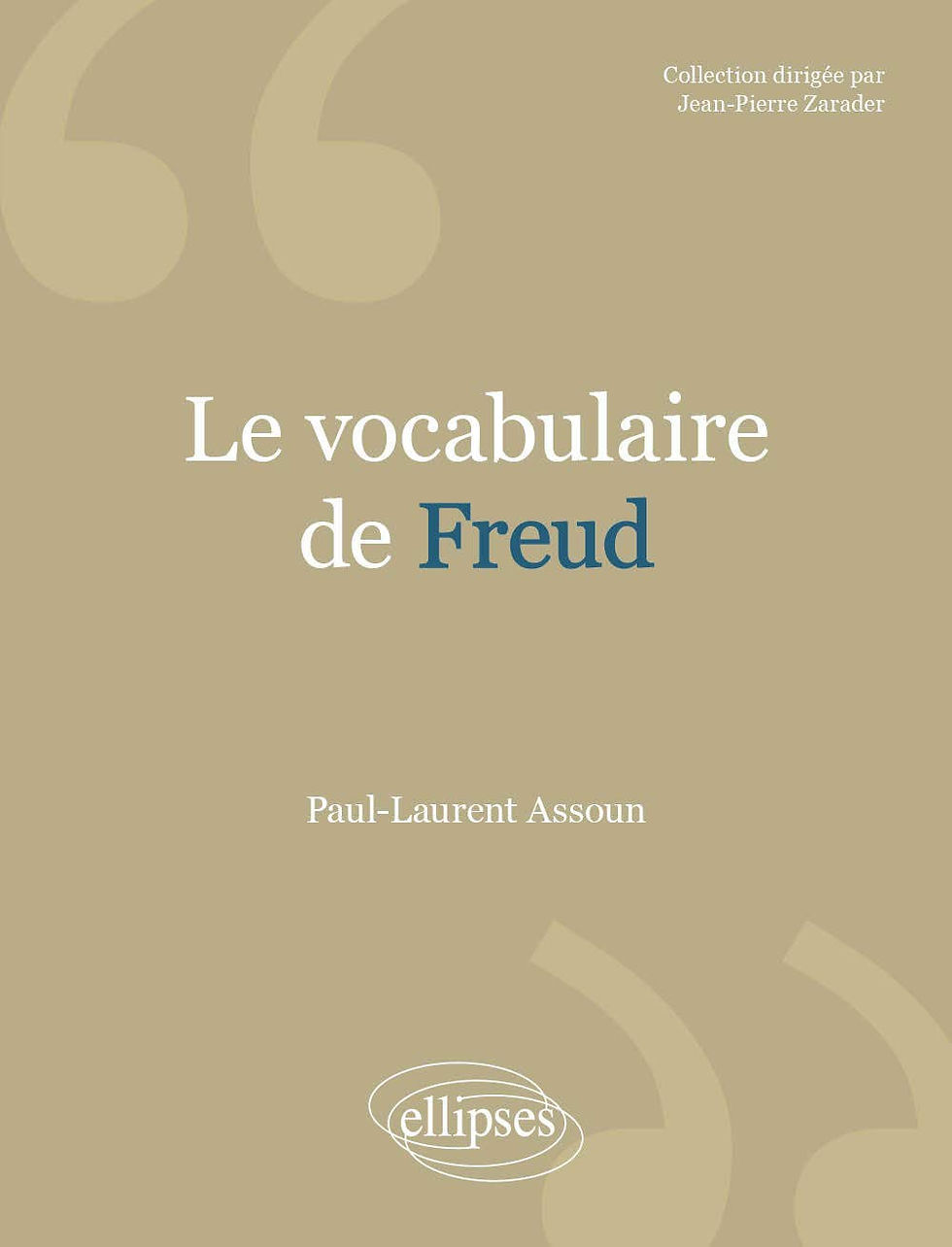
Commentaires