Fragonard : l'énergie de l'hystérie
- Fabrice LAUDRIN

- 26 févr. 2025
- 10 min de lecture
Fragonard, J. H. (vers 1767). Les hasards heureux de l'escarpolette

Un instant suspendu
Fragonard n’a pas peint une simple scène galante, il a mis en image un désir qui refuse de se fixer. Les Hasards heureux de l’escarpolette (vers 1767) est l'instant suspendu d'un mouvement oscillant où la séduction s’épanouit dans l’ambiguïté et l’évitement.
Tout est là : une femme projetée dans les airs, son jupon soulevé révélant l’impensable, un amant caché dans les fourrés qui guette avec ravissement ce dévoilement fugitif, et un mari qui, sans le savoir, donne lui-même l’impulsion à cette scène de tromperie théâtrale.
Fuite du désir
L’image raconte un jeu de regards et de non-dits, une mécanique où le désir est en perpétuelle fuite. La femme ne choisit pas, elle se laisse porter, tantôt projetée vers l’un, tantôt ramenée vers l’autre. L’amant attend, mais ne saisit rien ; le mari pousse, mais ne comprend pas ; et elle, légère et insaisissable, s’offre sans jamais se livrer. C’est une partition hystérique parfaite : le désir s’exhibe, mais se refuse, se donne, mais ne s’arrête jamais.
La balançoire est ici bien plus qu’un accessoire. Elle est la métaphore absolue de ce mouvement d’évitement, de cette oscillation entre deux pôles, où le plaisir ne se trouve ni dans l’un ni dans l’autre, mais dans l’entre-deux, dans ce passage incessant d’un regard à l’autre, d’un état à l’autre. L’amant est en attente, mais ne reçoit jamais ce qu’il désire pleinement ; le mari croit maîtriser la scène, mais alimente malgré lui ce qu’il ignore. Et elle, au centre, ne se pose jamais.
L’hystérique fonctionne ainsi : elle ne manque pas d’objets de désir, elle les enchaîne, les déplace, les rejoue, mais refuse de s’ancrer dans une possession réelle. Ce qui excite, ce n’est pas la rencontre, c’est le jeu du dévoilement et du retrait, le mouvement de l’objet du désir qui, au moment où il pourrait être saisi, repart dans l’autre sens.
Le travail analytique ne consiste pas à immobiliser ce balancement, mais à en révéler la mécanique. Pourquoi ce mouvement incessant ? Pourquoi ce besoin de l’Autre pour se définir, et en même temps cette impossibilité à s’arrêter sur une réponse ? L’hystérique ne fuit pas son désir, elle fuit l’idée qu’il puisse être comblé.
Dans Les Hasards heureux de l’escarpolette, la solution n’existe pas. L’image capture ce moment précis où tout est possible, mais où rien ne se décide. Une éternelle répétition. Un seuil qui ne se franchit pas. Un désir qui ne trouve jamais de repos.
Qu’est-ce que l’hystérie ? Une disparition ou une mutation ?
L’hystérie, terme chargé d’histoire et de malentendus, a longtemps été le terrain d’expérimentations médicales et psychanalytiques. Du théâtre des crises sous Charcot aux patientes de Freud, elle a été associée à des manifestations spectaculaires : convulsions, paralysies, pertes de voix, hallucinations. Tout cela semblait dessiner un portrait d’une maladie du corps féminin en souffrance, d’un désir enfoui qui cherchait à s’exprimer autrement.
Freud, en étudiant l’hystérie, comprend que ces symptômes ne sont pas le fruit d’une lésion neurologique, mais d’un conflit psychique. L’hystérique est celle – ou celui – qui désire, mais qui ne peut ni s’approprier ce désir ni l’assumer pleinement. Elle le projette ailleurs, sur l’Autre, dans une demande infinie de reconnaissance. Ce n’est pas le désir qui manque, c’est sa stabilisation qui est impossible. D’où cette oscillation permanente entre plainte et séduction, entre séduction et rejet, entre l’Autre et soi.
Aujourd'hui, l'hystérie a changé de costume
L’hystérie a peu à peu disparu des classifications psychiatriques modernes, effacée du DSM-III en 1980, puis définitivement écartée au fil des révisions suivantes. Ce retrait n’est pas anodin. Il répond à plusieurs raisons, d’abord historiques : trop longtemps associée aux femmes, elle a véhiculé un regard biaisé, nourri par des préjugés médicaux et sociaux. Ensuite diagnostiques : ses manifestations étaient si diverses qu’elles recouvraient une multitude de troubles sans véritable spécificité. Enfin, il s’agit d’une évolution clinique : ce que l’on nommait autrefois hystérie a été disséqué, redistribué, replacé dans des catégories plus précises, moins globalisantes, mieux définies.
Mais si le mot a disparu, son empreinte demeure. Aujourd’hui, les traits qui caractérisaient l’hystérie se retrouvent disséminés dans plusieurs diagnostics du DSM-5. Le trouble de la personnalité histrionique en porte l’héritage le plus direct : quête constante d’attention, exagération des émotions, besoin de séduire, difficulté à ancrer des relations profondes. Les troubles dissociatifs, eux, absorbent une autre facette de l’hystérie, celle qui faisait vaciller l’identité et le rapport à la mémoire : amnésies inexpliquées, personnalités multiples, états de conscience altérés. Les troubles somatoformes, quant à eux, reprennent la part corporelle de l’ancienne névrose, ces symptômes physiques sans cause organique, ces douleurs, ces paralysies, ces conversions de l’angoisse en chair. Enfin, les troubles factices et simulés, comme le syndrome de Münchhausen, en rejouent un autre versant : celui où le symptôme devient un appel, une mise en scène, une dramaturgie du corps pour capter l’attention.
Alors, l’hystérie a-t-elle disparu ? Officiellement, oui. Dans le langage clinique, elle n’existe plus en tant que telle. Mais sur le terrain de la psychanalyse, elle continue d’exister sous une autre forme. Elle n’est plus un diagnostic, elle est un mode d’être. Une manière de vivre le désir dans l’excès, la dramatisation, l’oscillation entre la séduction et l’évitement. Une façon de s’accrocher à l’Autre tout en le fuyant dès qu’il se précise. Freud l’avait décrite, Lacan l’a affinée, et malgré son éviction des classifications officielles, elle traverse encore les analyses, les relations humaines, les structures psychiques contemporaines. Simplement, elle a changé de costume.
L’hystérie vue par la psychanalyse du seuil : un passage toujours différé
Dans la psychanalyse du seuil, l’hystérie n’est pas une pathologie figée, mais une manière d’habiter l’entre-deux, un mode d’être qui oscille entre affirmation et fuite, entre appel et refus. Elle ne se définit plus uniquement par ses manifestations corporelles ou relationnelles, mais par un rapport problématique au passage – au franchissement d’un seuil intérieur ou existentiel qui ne se fait jamais.
Lorsque Freud voyait dans l’hystérique une souffrance liée au refoulement du désir, et Lacan une quête d’un Autre toujours insatisfaisant, la psychanalyse du seuil y voit un problème de modulation du mouvement psychique. L’hystérique n’est pas incapable de désirer, mais elle ne parvient pas à s’inscrire dans une dynamique fluide. Elle reste en suspension, en quête d’un regard, d’une validation, mais refuse de s’engager dans une transformation qui l’ancrerait dans un état stable.
Un désir toujours en fuite
L’hystérique vit dans une tension perpétuelle, une oscillation entre un pôle et son contraire. Elle séduit, mais dès que l’Autre répond, elle s’échappe. Elle dramatise le manque, mais lorsque ce manque pourrait être comblé, elle le relance autrement. Elle cherche un seuil, mais au lieu de le franchir, elle l’effleure, joue avec lui, l’habite sans jamais en faire une transition réelle.
Dans Les Hasards heureux de l’escarpolette, cette dynamique est parfaitement incarnée. La femme ne choisit pas : elle se laisse porter par le mouvement, passant d’un homme à l’autre sans jamais s’arrêter. L’amant attend un dévoilement, mais ce dévoilement est éphémère, suspendu dans l’air comme la chaussure qui s’envole. Le mari donne l’impulsion, mais ne sait pas ce qu’il alimente. Rien ne se fige, tout est un jeu de déplacement permanent.
Le refus du seuil : entre théâtralisation et dispersion
L’hystérique ne veut pas tant passer le seuil que l’habiter indéfiniment, le rejouer sous mille formes. Ce qui la trouble n’est pas l’absence de désir, mais la crainte qu’un désir trop assumé l’enferme dans une identité figée. Elle préfère donc mettre en scène son désir plutôt que de l’assumer pleinement. C’est le refus d’un "après", le rejet d’un état où elle pourrait dire : "Voilà, j’ai obtenu ce que je voulais."
Cette logique se retrouve aujourd’hui dans les dynamiques sociales et numériques : mise en scène du soi, survisibilité du désir, mais impossibilité de stabiliser une posture. Le regard de l’Autre est recherché, mais dès qu’il se pose, il devient étouffant. La psychanalyse du seuil voit là une peur d’habiter pleinement un état intérieur, une incapacité à tenir une position sans la remettre en question immédiatement.
Comment dépasser l’hystérie selon la psychanalyse du seuil ?
L’objectif n’est pas de "corriger" ce mouvement, ni de chercher à stabiliser artificiellement un désir qui, par essence, échappe. Il ne s’agit pas non plus de faire taire la mise en scène, car elle est une forme d’expression. Ce qui compte, c’est d’aider le sujet à accepter un point d’appui, à reconnaître qu’un désir assumé n’est pas nécessairement un désir enfermé.
L’hystérique ne manque pas d’intensité, elle manque d’une articulation entre ses états. Ce n’est pas qu’elle doit "choisir" une position, mais apprendre à se réaccorder à son propre mouvement sans être en fuite perpétuelle. La solution n’est pas d’arrêter la balançoire, mais de comprendre qu’elle n’a pas à être une oscillation infinie entre deux pôles opposés, qu’un instant d’arrêt ne signifie pas une perte de liberté.
Là où Freud cherchait à lever le refoulement, et Lacan à faire accepter le manque, la psychanalyse du seuil cherche à rétablir une modulation fluide du passage intérieur. Franchir un seuil ne signifie pas s’y enfermer, mais accepter qu’un mouvement ne doit pas être une fuite permanente pour exister pleinement.
Bibliographie
Histoire de l’Art et Analyse du Tableau
Bailey, C. (2011). Fragonard’s Playful Paintings: Rococo and the Art of Seduction. Yale University Press.
Conisbee, P. (1996). Fragonard: Art and Eroticism in Eighteenth-Century France. National Gallery of Art.
Cuzin, J. P. (1987). Jean-Honoré Fragonard: Life and Work. Abbeville Press.
Hyde, M. (2006). Making Up the Rococo: François Boucher and His Critics. Getty Research Institute.
Sheriff, M. D. (1990). Fragonard: Art and Eroticism. University of Chicago Press.
Posner, D. (1982). Jean-Honoré Fragonard: The Fantasy Figures. Kimbell Art Museum.
Scott, K. (2003). Rococo and Revolution: Eighteenth-Century French Painting and the Politics of Pleasure. University of Chicago Press.
Hystérie et Psychanalyse
Anzieu, D. (1985). Le Moi-peau. Dunod.
Bachelard, G. (1942). L’Air et les Songes: Essai sur l’imagination du mouvement. José Corti.
Benjamin, W. (1936). L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique. Zeitschrift für Sozialforschung.
Bergson, H. (1896). Matière et mémoire. Presses Universitaires de France.
Camus, A. (1942). Le Mythe de Sisyphe. Gallimard.
Charcot, J. M. (1892). Leçons sur les maladies du système nerveux faites à la Salpêtrière. Bureaux du Progrès Médical.
Ellenberger, H. (1970). The Discovery of the Unconscious: The History and Evolution of Dynamic Psychiatry. Basic Books.
Foucault, M. (1961). Histoire de la folie à l'âge classique. Gallimard.
Freud, S. (1895). Études sur l’hystérie (avec J. Breuer). Presses Universitaires de France.
Freud, S. (1900). L’Interprétation du rêve. Presses Universitaires de France.
Freud, S. (1919). L’Inquiétante étrangeté. In Essais de psychanalyse appliquée. Gallimard.
Jung, C. G. (1954). Les Racines de la conscience. Albin Michel.
Lacan, J. (1966). Écrits. Seuil.
Lacan, J. (1977). Le Séminaire, livre XI : Les Quatre Concepts fondamentaux de la psychanalyse. Seuil.
Merleau-Ponty, M. (1945). Phénoménologie de la perception. Gallimard.
Nancy, J. L. (2000). L’Intrus. Galilée.
Roudinesco, E. (1993). Histoire de la psychanalyse en France. Fayard.
Weil, S. (1947). La Pesanteur et la Grâce. Plon.
Yalom, I. (1980). Existential Psychotherapy. Basic Books.
Notions de psychanalyse croisées
L’Inquiétante étrangeté (Freud, 1919)
Freud définit l’inquiétante étrangeté (Das Unheimliche) comme cette sensation troublante qui surgit lorsqu’un élément familier devient soudainement étrange. Les Hasards heureux de l’escarpolette joue avec ce registre : une scène galante en apparence anodine, mais où la théâtralisation du désir et l’implication inconsciente du mari créent un malaise sous-jacent.
Le refoulement (Freud, 1900)
Le refoulement est le mécanisme inconscient par lequel des pensées ou désirs inacceptables sont maintenus hors de la conscience. Ici, la femme sur l’escarpolette symbolise un désir qui ne s’assume pas totalement : il est exhibé, mis en scène, mais jamais pleinement reconnu.
L’angoisse existentielle (Yalom, 1980)
L’angoisse existentielle résulte de la confrontation inévitable aux grandes thématiques de la condition humaine : la mort, l’isolement, la liberté, et l’absence de sens absolu. L’hystérique, en quête d’un Autre qui pourrait lui dire ce qu’elle est, évite cette confrontation en restant perpétuellement dans un entre-deux.
Le Moi-peau (Anzieu, 1985)
Le Moi-peau est cette enveloppe psychique qui permet au sujet de se sentir cohérent et contenu. Chez l’hystérique, cette enveloppe est poreuse, friable : d’où un besoin constant de s’accrocher à l’Autre pour exister, et une fuite dès que cet Autre devient trop envahissant.
Le stade du miroir (Lacan, 1936)
Le stade du miroir désigne le moment où l’enfant se reconnaît dans son reflet, structurant ainsi son ego par identification. Mais cette reconnaissance est illusoire : il ne se saisit pas lui-même, il s’identifie à une image extérieure. L’hystérique rejoue ce moment en cherchant perpétuellement son reflet dans l’Autre, sans jamais pouvoir se stabiliser.
L’Objet petit a (Lacan, 1977)
L’objet petit a est cet objet du désir inatteignable qui, justement parce qu’il échappe, alimente la quête du sujet. Dans Les Hasards heureux de l’escarpolette, la femme incarne cet objet fuyant : elle se dévoile sans jamais se donner, attise le regard tout en lui échappant.
Le Symbolique, l’Imaginaire et le Réel (Lacan, 1977)
Lacan divise la psyché en trois registres : le Symbolique (les règles et le langage), l’Imaginaire (les identifications et illusions) et le Réel (ce qui échappe à toute symbolisation). Ici, l’escarpolette oscille entre ces registres : elle est un jeu imaginaire de séduction, mais aussi un point où le Réel affleure – la trahison latente, l’absence de maîtrise du mari, la chute possible.
L’archétype de l’Ombre (Jung, 1954)
L’Ombre est la part cachée et refoulée de la psyché, tout ce que le sujet refuse d’admettre sur lui-même. La femme sur la balançoire incarne cette Ombre qui s’exprime sans retenue : la légèreté du jeu masque une transgression qui, dans une autre lecture, pourrait apparaître comme une révélation du désir caché du mari lui-même.
Le Vide et la temporalité suspendue (Bergson, 1896)
Bergson oppose le temps mécanique au temps vécu, fluide et élastique. Les Hasards heureux de l’escarpolette fige un instant d’indécision, un seuil sans résolution où tout pourrait basculer mais où rien ne se décide.
L’Expérience du Seuil (Merleau-Ponty, 1945)
Le seuil est cet espace où les repères vacillent, où l’on n’est ni d’un côté ni de l’autre. L’hystérique en fait son territoire : elle ne passe pas, elle oscille, elle habite le seuil comme un espace où elle peut exister sans avoir à choisir.
L’Attente et le silence (Weil, 1947)
Simone Weil parle du silence comme d’un espace où l’âme s’ouvre à quelque chose de plus grand. L’hystérique inverse ce rapport : l’attente devient une stratégie d’évitement, le silence un refus du franchissement, la mise en scène une manière de ne jamais se poser.
L’échec du passage (Camus, 1942)
Dans Le Mythe de Sisyphe, Camus décrit l’absurdité d’un effort sans fin. L’hystérique vit dans cet échec du passage : elle cherche une réponse qui, dès qu’elle semble apparaître, devient insupportable. Elle rejoue sans cesse la même scène, sans jamais atteindre de résolution.


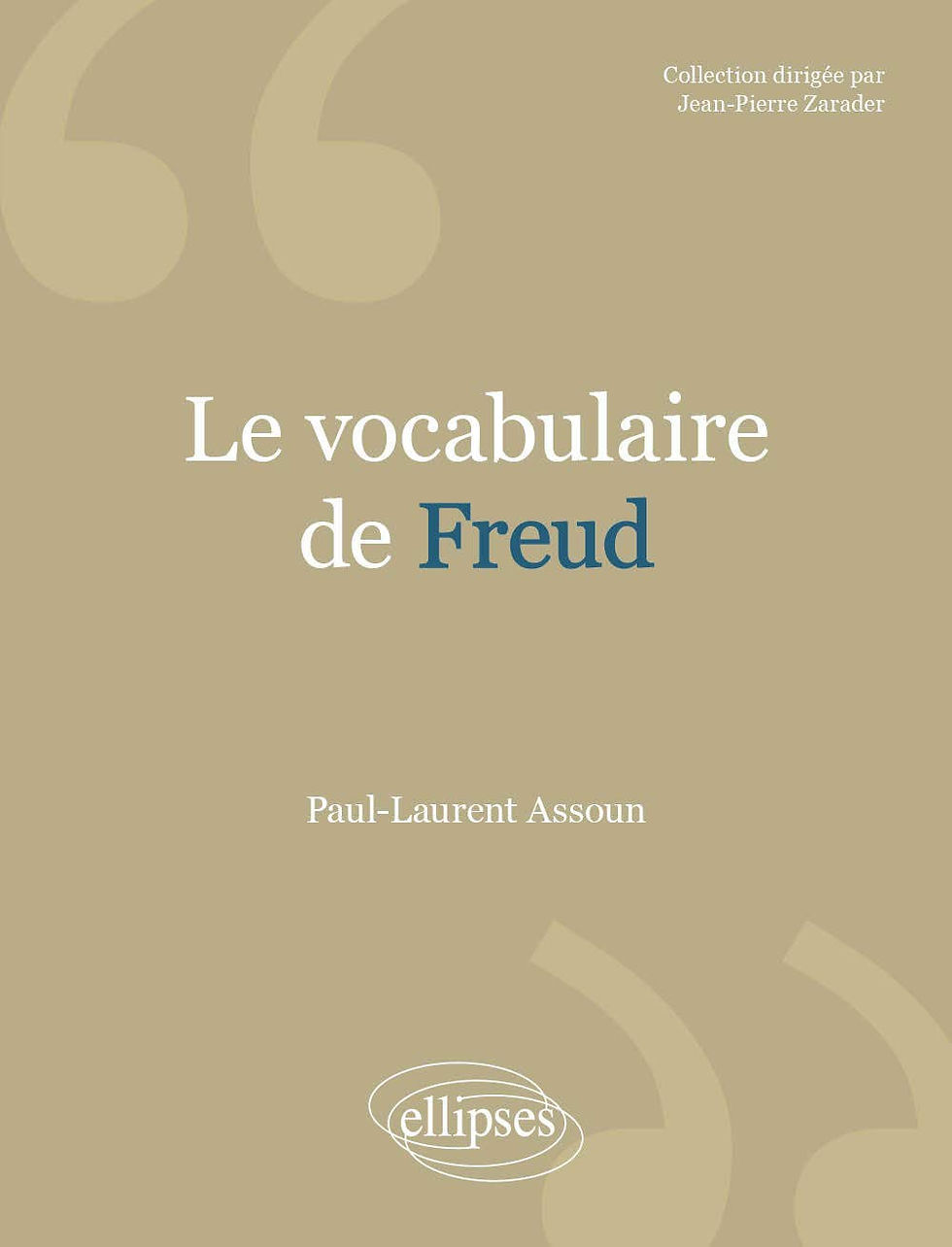

Commentaires